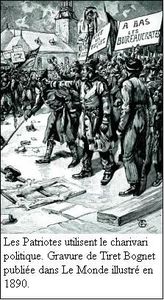Vendredi le 15 juin. Vol. 6, no. 19
labibfranco.canalblog.com
PAGE 1
Si les profs pouvaient
Stéphane Laporte, La Presse (19-09-09)
C'est en septembre que ça se décide. Parfois même dès le premier cours. La cloche sonne. Trente élèves s'assoient à leur pupitre. Trente paires d'yeux fixent la porte de la classe. Impatients de savoir de quoi a l'air le prof. Parfois sa réputation le précède et elle entre en premier. Les jeunes ont déjà peur. Les plus vieux leur ont dit qu'ils allaient passer par là. Ça peut aussi être le contraire. Les jeunes sont déjà turbulents. Baveux. Les plus vieux leur ont dit que c'était un mou.
 Le professeur arrive, les élèves l'analysent. Ils le scannent de la tête aux pieds. Sa démarche, son habillement, ses cheveux, son poil aux oreilles, son manucure, ses mèches, son parfum, son accent, ses tics. Ils n'ont que ça à faire. Le regarder. Durant toute la période. Alors ils le font. Quand le premier cours est terminé, leur idée est faite. Ils vont aimer ou pas le français, les mathématiques, la chimie, la biologie, la géographie ou l'éducation physique selon qu'ils aiment ou n'aiment pas M. Proulx, Mme Boily, M.Dutil ou Mme Bernier.
Le professeur arrive, les élèves l'analysent. Ils le scannent de la tête aux pieds. Sa démarche, son habillement, ses cheveux, son poil aux oreilles, son manucure, ses mèches, son parfum, son accent, ses tics. Ils n'ont que ça à faire. Le regarder. Durant toute la période. Alors ils le font. Quand le premier cours est terminé, leur idée est faite. Ils vont aimer ou pas le français, les mathématiques, la chimie, la biologie, la géographie ou l'éducation physique selon qu'ils aiment ou n'aiment pas M. Proulx, Mme Boily, M.Dutil ou Mme Bernier.
Je me demande à quel point les profs sont conscients que l'école c'est eux. Ce sont eux les stars. Ils sont les Guy A. Lepage, Julie Snyder, Marc Labrèche, Louis-José Houde de leur matière. Ce sont eux qui l'animent. Ce sont eux qui y donnent vie. Qui rendent ça intéressant ou ennuyant. Qui partagent leur passion. Si le prof est sur le pilote automatique, le cours va crasher, c'est sûr. Mais si le prof fait de la haute voltige à la Luchini, en récitant des vers ou en déclamant ses dictées, les élèves seront au septième ciel. Bien sûr, personne n'est condamné à être génial. Les profs sont comme les sportifs, les politiciens, les plombiers, les chroniqueurs, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Mais on ne devient pas cuisinier si on n'aime pas manger. Alors on ne devient pas professeur si on n'aime pas enseigner. Si on n'aime pas donner un cours. Donner une représentation. Pas besoin que le cours de physique devienne un spectacle du Cirque du Soleil, il faut juste que les élèves sentent que leur maître trippe sur la matière. Ça prend de l'entrain. De l'enthousiasme.
Combien d'heures j'ai passé à dessiner des bonshommes dans mon cahier parce que le prof lisait ses notes sans lever les yeux. Monotone. Fatigué. Résigné. Le courant ne passait pas parce que le prof était en panne. D'inspiration. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est en aimant. Si on ne fait pas aimer aux élèves ce qu'on leur demande de retenir, ils ne s'en souviendront jamais. L'indifférence n'a pas de mémoire.
Si j'aime autant écrire, c'est beaucoup à cause de Mme Lamoureux au primaire, M. Saint-Germain au secondaire et de M. Parent au cégep. Des profs qui l'avaient. Ce n'était pas des bouffons. Oh que non. Mais leur vocation était sincère et bien visible. Car c'est de cela que l'on parle. Tenir assis sur des sièges une trentaine de ti-culs pendant toute une journée, faut le faire. Même les parents ont de la misère à captiver leurs enfants durant un week-end. Imaginez durant une semaine, des étrangers se relayent pour essayer de transmettre connaissances, culture et savoir-vivre à un auditoire qui ne rêve qu'aux vacances de Noël. Faut le faire.
Et il n'y a qu'une seule façon de le faire. Pour intéresser, il faut être intéressant. Bien sûr, il y aura toujours des cancres qui resteront insensibles à un cours d'anglais même si c'était Angelina Jolie ou Brad Pitt (c'est selon) qui l'enseignait. Mais la grande majorité des élèves ne demandent pas mieux que d'embarquer. Encore faut-il que le monsieur ou la dame en avant veuille les mener plus loin que la fin du cours. Plus loin que la charge de travail imposée.
Le Québec est le royaume du décrochage. C'est peut-être parce que les jeunes ne sont jamais accrochés. C'est plate, mais c'est aux adultes de le faire. Les médecins ont la responsabilité de guérir les patients. Les profs ont le devoir d'intéresser les élèves. C'est bête de même. C'est beau de même.
C'est sûrement la plus noble des tâches. Permettre à un individu de grandir. Dans tous les sens du terme.
Si c'est le devoir des profs de stimuler leurs élèves, c'est le devoir de la société de stimuler les professeurs. En valorisant leur tâche. En structurant les écoles autour de leur talent. En leur permettant d'être imaginatifs.
Un professeur peut changer la vie de quelqu'un. Peu de gens ont ce pouvoir. Il peut être un allumeur de réverbères. Comme il peut être un éteignoir.
C'est en aidant les professeurs à être meilleurs que les élèves le seront. C'est la seule réforme possible.
L'école, qu'elle s'appelle l'école Champlain, l'école Élan ou l'école Sainte-Jeanne-D'arc, c'est l'école Pierre Dubois, c'est l'école Mlle Provencher, c'est l'école Virginie. C'est l'école des professeurs.
Quelqu'un devrait l'apprendre aux directeurs de commissions scolaires et aux sous-ministres.
Le dernier BON Weekend ?
Chers collègues
Vous avez en main notre dernière édition de BON Weekend.
Au début, il y a sept ans, il s'agissait de quelques photocopies d'articles pertinents, à la demande de la direction de Franco-Cité.
Très vite le lectorat grandissait; la revue prenait un air professionnel.
Sur invitation, notre publication a dépassé les murs de Franco-Cité.
Depuis un an nous partageons notre publication avec les autres écoles, les membres et personnel de notre Conseil.
BW est devenu un outil en classe, un stimulant de discussion et de partage.
Un ami journaliste, incognito au 4000 Labelle, se trouve dans l'ascenseur à côté de deux personnes.
L'un dit à l'autre: « As-tu lu l'article dans BON Weekend sur... »
Nous en étions fiers et stimulés à la perfection.
Notre travail, notre approche très perfectionniste, le temps qu'on y consacrait toujours avec passion, a fait de BW un instrument indispensable et précieux.
BON Weekend au top niveau, a dépassé le cadre d'une bibliothèque scolaire.
À moins de trouver une autre façon de produire, vous avez le dernier BON Weekend en main.
Merci pour vos mots d'appréciation.
Nous l'avons fait avec passion et fierté.
Paul de Broeck et Marc Robillard.
Bon Weekend est publié par LaBibFranco Publications
par Paul de Broeck et Marc Robillard.
LaBibFranco fait partie de l’E.S.C. Franco-Cité.
Directeur: Marc Bertrand. Adjoints: Valérie Roy, Anik Charrette et Annick Ducharme.
LaBibFranco Publications, 623 ch. Smyth, Ottawa, Ontario, Canada. K1G 1N7
Tél. 613-521-4999, poste #2467. Téléc. 613-521-8499 LaBibFraco@Gmail.com
Avec plus de 20 000 élèves fréquentant 38 écoles élémentaires, 10 écoles secondaires et son école pour adultes,
le CECCE est le plus important réseau canadien d’écoles de langue française à l’extérieur du Québec.
PAGE 2
L'humanité se rapproche de
la capacité limite de la Terre
Pierre Marc Tremblay, Le Devoir(02-06-12)
 La science indique que « les pressions exercées sur les écosystèmes terrestres poussent ces derniers vers leurs limites biophysiques et que ces limites sont presque déjà atteintes. Dans certains cas, elles sont déjà dépassées ».
La science indique que « les pressions exercées sur les écosystèmes terrestres poussent ces derniers vers leurs limites biophysiques et que ces limites sont presque déjà atteintes. Dans certains cas, elles sont déjà dépassées ».
Tel est bilan alarmant que dresse « GEO-5 », le cinquième bilan quinquennal de l’état de la planète du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). « GEO-5 » est publié à deux semaines de l’assemblée générale extraordinaire des Nations unies qui se tiendra à Rio du 20 au 22 juin prochain. Le premier de ces bilans avait été publié avant la conférence de Rio de 1992, qui avait débouché sur les deux conventions internationales sur la protection du climat et de la biodiversité.
« GEO-5 » lance un avertissement très clair : « Si l’humanité ne modifie pas d’urgence ses façons de faire, plusieurs seuils critiques vont être franchis, au-delà desquels des changements abrupts et généralement irréversibles pour les fonctions de base de la vie sur Terre pourraient se produire. »
« Si cette situation perdure, si les structures actuelles de production et de consommation des ressources naturelles continuent de prévaloir et si rien n’est fait pour inverser la tendance, les gouvernements devront assumer la responsabilité d’un niveau de dégradation et de dommages sans précédent », indiquait de son côté Achim Steiner, le directeur général du PNUE.
Le bilan dressé par « GEO-5 » indique sur 90 objectifs majeurs, convenus par la communauté internationale, des progrès significatifs ont été accomplis dans seulement quatre de ces dossiers, soit la protection de la couche d’ozone, l’élimination du plomb dans l’essence, l’accès à une eau de meilleure qualité et l’intensification de la recherche sur la pollution des mers.
Des progrès « mitigés » ont été enregistrés dans l’atteinte de 40 autres objectifs, notamment par l’augmentation des aires protégées, qui couvrent 13 % des terres émergées, et la réduction du taux annuel de déforestation, qui est passé de 16 à 13 millions d’hectares entre 2000 et 2010.
Peu ou pas de progrès du tout caractérisent 24 autres objectifs que s’est aussi donnés la communauté internationale dans les dossiers touchant notamment le climat, les stocks de poissons, la lutte contre la désertification et les sécheresses. Dans huit autres des 90 dossiers prioritaires, « GEO-5 » constate même d’importantes détériorations de la situation, notamment dans le cas des récifs coralliens, pour lesquels il n’existe aucun bilan global. Dans 14 autres dossiers pourtant dotés eux aussi d’objectifs acceptés au niveau international, aucune conclusion n’a été possible faute de données, précise le rapport.
 Dans certains domaines comme la très classique pollution chimique, précise « GEO-5 », la possibilité de dresser un bilan réaliste est tout simplement hors de portée parce que le nombre de produits chimiques ne cesse d’augmenter, que les gouvernements nationaux ne dressent aucun bilan pour tous les produits, y compris pour leurs sites les plus contaminés, et aussi parce que de nouveaux contaminants comme les nanoparticules ne font encore l’objet d’aucun bilan.
Dans certains domaines comme la très classique pollution chimique, précise « GEO-5 », la possibilité de dresser un bilan réaliste est tout simplement hors de portée parce que le nombre de produits chimiques ne cesse d’augmenter, que les gouvernements nationaux ne dressent aucun bilan pour tous les produits, y compris pour leurs sites les plus contaminés, et aussi parce que de nouveaux contaminants comme les nanoparticules ne font encore l’objet d’aucun bilan.
Bilans sectoriels
« GEO-5 » attribue à l’adoption d’objectifs et d’échéanciers précis les succès remportés dans la lutte contre les substances destructrices de la couche d’ozone et le plomb dans l’essence. Or c’est précisément ce qui manque, selon « GEO-5 », dans la lutte contre les changements climatiques : au rythme actuel et malgré les réductions d’émissions en Europe, la planète se dirige vers une augmentation de 3 °C de sa température moyenne d’ici la fin du siècle, ce qui pourrait lui coûter un peu plus de 2 % du PIB mondial. Et la tendance s’alourdit même : en 2010, le taux d’émissions lié à la combustion de pétrole et de charbon a atteint des records de tous les temps.
La pollution de l’air, un des premiers dossiers attaqués en environnement, continue de faire 2 millions de morts prématurées, dont 900 000 enfants de moins de cinq ans, en raison de l’usage de combustibles impropres dans les maisons. Globalement, les particules fines tuent 3,7 millions de personnes par an et le smog ajoute 700 000 morts pour cause de difficultés respiratoires, dont 75 % en Asie. Les pertes de récoltes agricoles pour cause de pollution de l’air coûteraient entre 14 et 26 milliards $US par année.
Le deuxième problème en importance ciblé en 1992, soit le déclin de la biodiversité, fait aussi l’objet d’un constat d’échec, car malgré l’adoption des Objectifs du millénaire en 2000, aucun ralentissement sensible de ce déclin n’a été atteint en 2010. Une espèce de vertébré sur cinq est actuellement menacée. Les facteurs de survie des récifs coralliens ont diminué de 38 %, le déclin record en matière de biodiversité. Parce que l’agriculture accapare désormais 30 % de la surface terrestre, plusieurs des grands écosystèmes ont perdu jusqu’à 20 % de leurs aires naturelles depuis 1980.
Par contre, les aires protégées par les gouvernements couvrent 13 % des surfaces émergentes, mais seulement 1,6 % des espaces marins. Il faudrait protéger 17 % et 10 % de ses aires naturelles d’ici 2020, selon la récente conférence d’Aicha au Japon.
Quant aux stocks de poissons, les captures ont quadruplé entre 1950 et 1990, mais on commence à les stabiliser, ce qui ne permet pas encore aux stocks de se reconstituer en raison des surpêches commerciales principalement. Plus de 60 % des espèces marines sont exploitées aux seuils de rupture et souvent au-delà.
Partout dans le monde, les nappes souterraines sont surutilisées tout comme les cours d’eau, dont les pollutions sont de moins en moins suivies par les gouvernements, y compris les nanoparticules qui y font leur apparition. Les inondations et les sécheresses extrêmes, qui menacent les réserves en eau, ont augmenté respectivement de 230 % et de 38 % entre 1980 et 2000, exacerbées par le réchauffement du climat.
PAGE 3
Petite leçon de
meurtre à l'école
Patrick Lagacé, La Presse (13-06-12)
Dans la catégorie «manque de jugement», un prof d'histoire et éducation à la citoyenneté de l'école secondaire Cavelier-de-LaSalle, dans l'ouest de Montréal, détient une sérieuse option sur le titre. Lundi dernier, à ses élèves de 4e secondaire, il a fait regarder la vidéo sordide du meurtre dont Luka Rocco Magnotta est accusé.
Vous avez bien lu: LA vidéo qui montre les derniers moments de l'étudiant Lin Jun. Oui, celle-là, celle qui donne mal au coeur, celle qui a mené à l'arrestation de Luka Rocco Magnotta en Allemagne, celle qui pourrait lui valoir des accusations de meurtre et d'outrage à un cadavre, une fois qu'il reviendra à Montréal.
Quand j'ai reçu l'information, je n'y croyais pas. Trop gros. Mais vérification faite auprès de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, hier, l'histoire est véridique.
Lundi matin dernier, donc, pour des raisons inconnues, cet enseignant a décidé de faire visionner à ses élèves la vidéo en question, en classe. Plusieurs élèves ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu. Évidemment, l'affaire a rapidement fait le tour de l'école.
C'est un directeur adjoint de l'école qui, sur l'heure du midi, a appris d'un élève que la terrible vidéo avait été montrée à des élèves, pour la plupart âgés de 16 ans. L'enseignant a été suspendu sur-le-champ, avec salaire, conformément à la convention collective.
«Ce n'est pas un moment de gloire, c'est désolant et ça nous dérange énormément, m'a déclaré Diane Lamarche-Venne, présidente de la commission scolaire, hier. C'est une initiative personnelle de ce professeur, une initiative que tout le monde condamne, tant à l'école qu'à la commission scolaire.»
Qui est ce prof? Pourquoi a-t-il pris la décision insensée de montrer à des ados une vidéo unanimement décrite comme insupportable? Y voyait-il une valeur pédagogique?
Mme Lamarche-Venne a été prudente dans ses commentaires, pour ne pas entraver le processus disciplinaire. L'enseignant, que la présidente de la CS Marguerite-Bourgeoys m'a décrit comme n'étant «pas un régulier» de l'école secondaire Cavelier-de-LaSalle, pourra présenter sa version des faits ce matin.
Selon ce que j'ai appris, il a envoyé un courriel à ses collègues de l'école, la semaine dernière, s'excusant de sa décision de montrer ces images épouvantables à ses élèves.
Le lendemain du visionnement, mardi dernier, la CS Marguerite-Bourgeoys a constitué une cellule de crise à l'école, avec un psychologue et des psychoéducateurs, pour permettre aux élèves de s'exprimer. «C'était important qu'ils aient quelqu'un à qui parler de ce qu'ils ont vu, pour rationaliser l'événement.»
Que des psys débarquent dans une école est une procédure normale, un peu partout au Québec, dans les cas d'événements troublants qui perturbent la vie scolaire. La décision de dépêcher à Cavelier-de-LaSalle une cellule de crise tombait sous le sens, dès que la direction de la commission scolaire a eu vent de l'affaire.
«Beaucoup de choses ont été dites sur cette vidéo, relate Diane Lamarche-Venne. Par exemple, le Service de police de la Ville de Montréal a déconseillé aux gens de tenter de la visionner, parce que c'est dérangeant.»
Au téléphone, hier, Mme Lamarche-Venne a fait face aux questions vaillamment, sans se défiler. L'école et la CS n'ont rien à voir avec la décision incroyablement imbécile du prof, mais, pourtant, l'école et la CS se retrouvent dans La Presse sous un éclairage peu flatteur, ce matin. En plus, pour respecter le processus disciplinaire, Mme Lamarche-Venne devait peser chacun de ses mots. Bref, je me sentais mal pour elle...
Au Syndicat de l'enseignement de l'ouest de Montréal, le président, Luc Jacob, a dit vouloir observer un certain devoir de réserve, le temps que la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys finisse son enquête. «Je n'ai pas parlé à cet enseignant, je ne le connais pas. Nous allons aviser quand nous aurons les résultats de l'enquête.»
PAGE 4
À l'école de la transparence
Marie-Claude Lortie, La Presse (03-06-12)
Si un écolier fréquentant la même institution que mes enfants était agressé sexuellement dans un véhicule de la STM, près de l'école, j'aimerais le savoir.
Si l'individu était ensuite repéré devant l'école, une de ses victimes l'ayant reconnu, j'aimerais le savoir vite.
J'aimerais le savoir pour pouvoir en parler à mes enfants avant que les rumeurs ne leur fassent peur. Pour leur donner l'heure juste et leur expliquer comment se protéger.
J'aimerais le savoir parce que des pédophiles, ça existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit de quelques mères hystériques. Ils sont heureusement rares. Mais éviter d'affronter le problème n'aide rien ni personne.
Je vous parle de tout ça parce qu'au cours de l'hiver, une situation semblable s'est produite dans la métropole, au Collège de Montréal.
Un après-midi de décembre, après l'école, un jeune de 13 ans attend le bus, le 24, rue Sherbrooke, près d'Atwater. Arrive un homme qui prétend le connaître, veut l'emmener au cinéma. Le garçon le repousse et prend le bus, dans lequel l'homme le suit et éventuellement le coince, le touche et essaie de l'embrasser. L'adolescent réussit à s'enfuir et rentre chez lui en larmes. Il raconte tout à ses parents, qui appellent la police et alertent l'école.
«Pour moi, il était clair que l'école devait être informée. Pour mon fils qui venait de vivre quelque chose de très grave. Mais aussi pour que les autres parents soient au courant», explique la mère.
L'école préfère ne pas en parler aux parents.
«On a choisi l'approche élève», explique le directeur, Jacques Giguère.
On «intervient» donc dans les classes pour «parler» aux jeunes. A-t-on utilisé le mot « pédophile « et a-t-on précisé qu'un crime avait été commis dans l'autobus passant devant l'école? Non.
Selon le directeur, l'école a choisi une approche moins précise. «On ne pensait pas opportun d'ameuter les jeunes. On n'a pas fait ce choix-là.»
Le temps passe, nous voilà rendus le 16 mai, et la jeune victime aperçoit de nouveau son agresseur devant l'école.
Il en parle à sa mère, qui alerte la police et le collège par courriel: «Je vous envoie une description de cet homme. Je crois que vous devriez avertir les élèves et les parents qu'il y a un prédateur dans la région et on devrait rappeler aux enfants ce qu'il faut faire s'ils sont approchés par un tel étranger... L'homme fait environ six pieds, il a une barbe et une moustache grises et des cheveux tirés en queue de cheval... Sa moustache est jaunie... Il portait un trench-coat noir long, et un pantalon rouge et violet qui ressemblait à un pyjama...»
Les jours passent, et toujours pas de courriel de l'école aux parents.
Le 22 mai, la mère réécrit. «Bonjour, je viens de parler au détective du SPVM [...] qui fait une enquête au sujet de l'homme qui a agressé [...]. Il suggère que les parents du collège soient avisés. J'attends toujours votre plan concernant cette situation.»
Puis, le lendemain, les événements prennent une tournure inattendue.
La mère aperçoit quelqu'un devant la station de métro Vendôme. Pantalon qui a l'air d'un pyjama. Queue de cheval, sac à dos, barbe énorme et moustache jaunie... Elle est certaine que c'est lui. Elle suit l'individu et appelle la police, qui arrête l'homme, un récidiviste que la jeune victime identifie sans hésiter.
Le surlendemain, un courriel du collège aux parents des élèves leur apprend qu'un «individu louche» rôdait autour du collège, mais qu'heureusement, il a été arrêté. La lettre invite tout le monde à la prudence.
Lorsque ce message est envoyé, Amir Pourasadi, 56 ans, est déjà entre les mains de la police. Il est toujours détenu. Une évaluation psychiatrique déterminera s'il est apte à son procès. Son dossier criminel, qui remonte à 1992, inclut des voies de fait, des voies de fait armées, des menaces de mort, non-respect de conditions, etc. Il fait aussi l'objet de deux enquêtes pour agressions dans le bus 55 contre des filles.
Hier, après mon entrevue avec M. Giguère, un message a été envoyé aux parents, expliquant qu'un écolier a été victime d'agression sexuelle et qu'un suspect a été arrêté. Cinq mois après le crime, les mots sont finalement écrits en toutes lettres.
Selon le directeur, la discrétion dont l'école a fait preuve s'explique surtout par une volonté de respecter le caractère «délicat» du dossier. «Même les parents sont mitigés sur la nécessité d'informer», dit-il.
Mitigés?
Comme le répète le directeur, l'école ne peut pas surveiller tout le quartier ni tous les bus. Il n'y a qu'une façon de prévenir: parler aux enfants pour qu'ils sachent comment réagir. Et lever les tabous.
Pourquoi, là comme si souvent dans ces histoires, sent-on une crainte de dire les mots? Pourquoi faut-il des arrestations pour admettre publiquement l'existence d'un crime? Est-ce de la gêne? De la peur? De la prudence exagérée? Du déni?
Pourquoi, si souvent, ce terrible ingrédient: le silence?
Pourquoi, si rarement, ce seul début de solution: la transparence?
Une leçon à réviser pendant l'été pour toutes les écoles.
PAGE 5
Passer l'été à gauche
Louis Cornellier, Le Devoir (09-06-12)
Cet été, entre deux séances de martelage de casseroles — ce qui vaut mieux, on en conviendra, que du matraquage de manifestants —, les percussionnistes improvisés qui en ont soupé des politiques de droite qu’on nous impose au nom du réalisme voudront probablement se redonner des forces en lisant des ouvrages qui, au-delà des slogans, expliquent les raisons de leur colère. Voici, pour eux et pour ceux qui ne les comprennent pas encore, un petit programme de lecture orienté à gauche, composé d’essais québécois publiés depuis septembre dernier.
Je l’ai écrit en février dernier et je le répète : si vous n’avez qu’un ouvrage à lire cet été, que ce soit Comment mettre la droite K.-O. en 15 arguments (Stanké, 2012), de l’indispensable Jean-François Lisée. Ce livre est l’essai — clair, polémique et efficace —qu’attendaient tous les sociaux-démocrates du Québec pour pouvoir répliquer à leurs détracteurs. Non, démontre Lisée, le Québec n’est pas un enfer fiscal, n’est pas infesté de fonctionnaires, n’est pas victime de son syndicalisme et n’est pas sur le point de déclarer faillite. Non, continue-t-il, les Québécois n’ont pas un niveau de vie plus faible que leurs voisins et ne sont pas les quêteux de la fédération canadienne. Statistiques à l’appui, Lisée démolit allègrement les allégations chagrines de la droite québécoise et explique, au surplus, pourquoi le mouvement souverainiste n’a pas dit son dernier mot. Tout ça, simplement et lumineusement.
En guise de complément à l’essai de Lisée, il faut lire celui de son ami Stéphane Gobeil, Un gouvernement de trop (VLB, 2012). Conseiller de Pauline Marois, Gobeil s’est livré à un travail de moine en épluchant les comptes publics du Canada de l’année 2010. Sa démonstration manque un peu de fini, mais elle indique néanmoins que l’idée du fédéralisme rentable pour le Québec est bel et bien un mythe. Non seulement, démontre Gobeil, les Québécois ne se reconnaissent plus dans le Canada, mais ils en font les frais sur le plan économique. Pourquoi, dans ces conditions, s’encroûter dans cette union étouffante ?
 Françoise David a peut-être hésité il y a plusieurs années, mais elle est partante, aujourd’hui, pour l’aventure du Québec souverain. Dans De colère et d’espoir (Écosociété, 2011), son beau « carnet » publié en novembre dernier, la co-porte-parole de Québec solidaire raconte son parcours de militante et elle redit, surtout, qu’elle « ne supporte plus l’indifférence et le silence des partis politiques face aux inégalités ». Françoise David incarne avec noblesse une gauche québécoise décomplexée qui refuse d’accepter l’injustice au nom d’un supposé réalisme. Un peu comme Madeleine Parent, elle combine la douceur d’expression et la détermination politique pour dire que le mépris n’aura qu’un temps.
Françoise David a peut-être hésité il y a plusieurs années, mais elle est partante, aujourd’hui, pour l’aventure du Québec souverain. Dans De colère et d’espoir (Écosociété, 2011), son beau « carnet » publié en novembre dernier, la co-porte-parole de Québec solidaire raconte son parcours de militante et elle redit, surtout, qu’elle « ne supporte plus l’indifférence et le silence des partis politiques face aux inégalités ». Françoise David incarne avec noblesse une gauche québécoise décomplexée qui refuse d’accepter l’injustice au nom d’un supposé réalisme. Un peu comme Madeleine Parent, elle combine la douceur d’expression et la détermination politique pour dire que le mépris n’aura qu’un temps.
Tonitruant sur la place publique, le regretté Pierre Falardeau n’était pas qu’un gueulard, mais aussi un artiste profond et tourmenté. La publication, en novembre dernier, d’Un très mauvais ami (Lux, 2011), sa correspondance avec le peintre néerlandais Léon Spierenburg qui était son ami, offre au lecteur l’occasion d’entrer dans la pensée intime du cinéaste. Viscéralement révolté devant l’injustice, Falardeau a fait de sa vie et de son oeuvre un engagement de tous les instants pour l’indépendance, non seulement celle de son peuple, mais aussi celle de tous les peuples entravés et celle de l’individu face aux pouvoirs écrasants. Dans son dernier scénario, Le jardinier des Molson (Du Québécois, 2012), il met en vedette des soldats québécois et sénégalais, sacrifiés sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale au profit de leurs exploiteurs coloniaux respectifs. S’il fallait résumer en quelques mots l’oeuvre de Falardeau, il faudrait retenir qu’elle fut un rugueux mais beau chant de libération.
On ne peut pas en dire autant de la majorité des films hollywoodiens qui occupent les écrans du monde entier. Dans Hollywood et la politique (Écosociété, 2012), l’écrivain et militant Claude Vaillancourt analyse plus de 150 de ces productions qu’il divise en trois catégories : le cinéma du statu quo, le cinéma du questionnement et le cinéma subversif. Il ne s’agit pas, pour l’essayiste, de rejeter en bloc le cinéma de l’empire, qu’il dit par ailleurs apprécier, mais d’offrir au cinéphile une grille d’analyse lui permettant de séparer le bon grain artistique et politiquement critique de l’ivraie propagandiste. Comme lecture d’été intelligente, cet essai original, solide et accessible est idéal.
Liliane est au lycée (Flammarion, 2011), l’essai de Normand Baillargeon sur la culture générale, l’est tout autant. « Est-il indispensable d’être cultivé ? », demande Baillargeon, quand on considère que la culture qui mérite le statut de « générale » n’est pas à l’abri de la critique ? N’est-elle pas, en effet, affectée de biais élitiste, sexiste et occidentalo-centriste ? C’est pourtant elle, explique Baillargeon, qui fournit les outils nécessaires à sa propre critique. Pour critiquer la culture générale, en d’autres termes, il faut en avoir. C’est elle qui élargit « l’éventail des possibles entre lesquels il nous est possible de choisir et de nous choisir et contribue ainsi à forger à la fois notre identité et notre autonomie » ; c’est elle, encore, dans ses versions artistiques et littéraires, qui contribue, « par la culture de l’imagination, à l’extension de la sympathie et à briser ces barrières qui interdisent de voir l’Autre comme un être humain ». La culture générale, explique simplement et justement Normand Baillargeon, humanise et libère.
Même s’ils se réclament d’un conservatisme plus identifié à la droite qu’à la gauche, l’historien Éric Bédard et le sociologue Mathieu Bock-Côté partagent ce dernier constat. Le premier dans Recours aux sources (Boréal, 2011) et le second dans Fin de cycle (Boréal, 2012) invitent les Québécois à renouer avec leur mémoire longue, c’est-à-dire canadienne-française, pour raffermir leur identité québécoise qui, disent-ils, ne se résume pas au progressisme social-démocrate. Mê-me en faisant le choix de passer l’été à gauche, il n’est pas interdit de lire ces essayistes de haut vol, par ailleurs brillants stylistes, tant il est vrai que le dogmatisme, peu importe sa couleur, demeure détestable.
PAGE 6
Un choix douteux
Julie Decoste, René Nault, Nathalie Tremblay
et Stéphane Lance, La Presse(11-06-12)
 Les auteurs sont enseignants au secondaire
Les auteurs sont enseignants au secondaire
Sans consultation du milieu scolaire et à la surprise générale, le gouvernement Charest a annoncé lors du discours inaugural de février 2011 qu'il implanterait des tableaux blancs interactifs (TBI) dans toutes les classes du Québec. Ce programme engloutira plus de 240 millions de dollars en cinq ans.
Après une campagne de séduction savamment orchestrée avec dons de matériel à différents intervenants du milieu scolaire, Smart Technologies est le choix des deux tiers des commissions scolaires, dont la CSDM. Pourtant, cette technologie manque de souplesse tout en étant l'une des plus dispendieuses sur le marché. Comme le hasard fait bien les choses, un ex-membre du cabinet du premier ministre avait obtenu en février 2011 le mandat de faire du lobbying pour Smart Technologies!
Nous croyons que d'autres produits devraient nous être offerts et que le fournisseur choisi tente de relancer son entreprise aux frais des contribuables. La valeur en Bourse des actions de Smart Technologies est passée de 17$ à 3,57$ en quelques mois. Des investisseurs ont même déposé une demande de recours collectif de 100 millions contre Smart Technologies, estimant avoir été floués. Nous exigeons un plus grand choix technologique et de la transparence sur l'attribution des contrats.
Sous prétexte d'un retard technologique et pour contrer le décrochage scolaire, on veut nous imposer un outil pédagogique qui n'a aucunement fait ses preuves et qui n'est appuyé par aucune étude indépendante, sinon celles des fabricants. En Angleterre, où toutes les classes sont équipées de TBI depuis 2007, les résultats aux examens internationaux ne sont pas meilleurs que ceux des élèves du Québec, selon des chercheurs de l'Université de Montréal.
Nous sommes les spécialistes en éducation et pourtant, le gouvernement fait fi de notre expertise et nous impose un choix à prendre ou à laisser. Nous y voyons une attaque directe à notre autonomie professionnelle alors que les outils pédagogiques doivent être choisis par les enseignants, non par le ministère de l'Éducation, influencé par des entreprises privées avides de profits sans égard aux besoins réels.
Nous exigeons le respect de notre profession et nous désirons participer à tout projet de développement des nouvelles technologies.
Soyons clairs: les enseignants ne rejettent pas les nouvelles technologies. Mais l'ingérence abusive du ministère et l'imposition mur à mur de ce programme sont inacceptables. De plus, cette stratégie est vouée à l'échec sans un plan de formation appropriée pour les enseignants et d'un plan d'entretien du matériel.
Nous croyons que le projet d'acquisition des TBI n'est pas motivé par des intérêts pédagogiques et risque d'être un vaste gaspillage.
PAGE 7
Violence à la télé:
insensibles, agressifs
Marie-Danielle Lemieux, La Presse(13-06-12)
L'auteure est doctorante à l'Université Laval et professionnelle au services de psychologie dans une commission scolaire. Elle prépare une thèse sur la violence dans les écoles.
J'aimerais bien croire que toutes ces heures consacrées à consommer de la violence sur les petits ou grands écrans sont sans importance, mais le fait est aujourd'hui avéré: elles augmentent les comportements violents. Pire, elles rendent insensible. De nombreuses études le confirment.
petits ou grands écrans sont sans importance, mais le fait est aujourd'hui avéré: elles augmentent les comportements violents. Pire, elles rendent insensible. De nombreuses études le confirment.
Des enfants exposés à des images violentes n'interviennent pas si un camarade se fait
agresser devant eux, ils l'ignorent. Ils deviennent de moins en moins empathiques, ont moins de compassion et sont davantage dépourvus de jugement. Les images violentes modifient notre représentation du monde.Les mécanismes neurophysiologiques sont aujourd'hui connus grâce à l'imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRMF). Les films violents ou d'horreur réduisent l'activité du cortex frontal, impliqué dans le contrôle des conduites agressives comme l'a rapporté une imposante étude transnationale de l'UNESCO.
Mais comment ces images opèrent-elles? Primo, elles augmentent la propension à agir avec violence ou agressivité, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. Secundo, elles élèvent notre seuil de tolérance à la violence, c'est l'habituation. Et, finalement, elles augmentent nos sentiments de peur et d'insécurité. Ces mécanismes seraient les mêmes chez les enfants, les adolescents et les adultes. Le cerveau sélectionne souvent à notre insu des réponses cognitives et comportementales.
Plusieurs études ont confirmé que chaque heure de programmes violents, consommée par des enfants de 2 à 5 ans, multiplie par quatre la probabilité d'observer des troubles du comportement non seulement dans les heures qui suivent, mais aussi dans les cinq prochaines années. Conséquences à court, mais aussi à long terme. À force d'être répétées, ces images finissent par imprégner nos représentations sociales inconscientes.
Le spectateur moyen serait exposé à des dizaines d'actes violents par heure soit près de 2600 crimes et actes violents par année. Soixante pour cent des émissions télévisuelles contiennent des scènes de violence. Ce nombre augmente à 70% quand il s'agit d'émissions pour enfants. Curieusement, ce sont les dessins animés qui en présentent le plus. Pas étonnant que l'on devienne moins enclin à porter secours à un inconnu sur la rue. Toutes ces heures de violence virtuelle amoindrissent nos facultés d'empathie.
Loin de moi l'idée de faire de ceux qui regardent des films d'horreur des psychopathes en puissance. Mais prétendre que l'on peut visionner 50 000 meurtres et avoir toujours le même jugement social me laisse plus que perplexe. Nombre de travaux, études, recherches ont confirmé que la violence est contagieuse.
Nous ne sommes plus à l'heure de nous demander si la violence sur les écrans augmente les comportements violents: le fait a été démontré à maintes reprises et confirmé par la recherche. Grâce au développement des neurosciences, on en connaît aujourd'hui davantage sur le fonctionnement du cerveau humain. La violence comme l'empathie s'apprendraient dès le plus jeune âge. La compassion s'enseigne par les parents d'abord puis par les apprentissages de la socialisation à l'école.
Les troubles de comportement concernent surtout les enfants dont la personnalité est mal structurée et l'identité mal construite. Les adultes ont un rôle prépondérant dans cet exercice. Ceux qui ne reçoivent pas l'attention et l'affection nécessaires à leur développement peuvent développer des problèmes relationnels importants.
Peut-être n'éradiquerons-nous jamais l'existence des «serial killers», mais en parler un peu moins et cesser d'en faire des héros de films, serait déjà un pas dans la bonne direction.
PAGE 8
Les souliers de Caballo Blanco
Yves Boisvert, La Presse (11-06-12)
François Bourdeau sort de son sac un t-shirt. «Micah True courait avec ça, c'est sa blonde qui me l'a donné.»
Le Montréalais de 39 ans est ému. Il essaie de résumer pour moi la série chaotique de hasards qui a mené cet ancien fumeur du fond d'un fauteuil à bascule jusque dans les canyons de la Sierra Madre, où il a partagé des heures de course, des repas, plein de silences et une amitié avec le Caballo Blanco.
Le Cheval blanc: c'est ainsi que les Indiens Tarahumaras ont surnommé Micah True, Américain venu s'installer chez ce peuple de
coureurs, dans le Copper Canyon, en bordure de la Sierra Madre, aussi bien dire nulle part.
True et les Tarahumaras ont atteint un statut mythique depuis que le journaliste Christopher McDougall en a raconté l'histoire dans le best-seller Born to Run, en 2009.
True, ancien hippy d'Hawaii devenu boxeur puis ultramarathonien, s'est installé dans cette région désertique. Il y organisait depuis 2006 une course de 80 km qui fait trois boucles autour du village d'Urique, entre des Tarahumaras et des coureurs invités personnellement par le Caballo. Ils étaient 420 Tarahumaras cette année et 80 étrangers, dont François Bourdeau.
***
Le livre de McDougall raconte que ces Indiens du canyon, dont plusieurs vivent dans des villages inaccessibles par la route, sont des coureurs nés. Jeunes ou vieux, ils courent des kilomètres chaque jour. Leurs jeux sont des courses interminables autour d'une balle en bois.
Quelques promoteurs américains avaient recruté des Tarahumaras pour participer à des ultramarathons dans les années 90. Ils ont renversé tous les experts en remportant les épreuves de 100 km en rigolant et, surtout, en courant avec des sandales en cuir.
Après avoir été montrés comme des animaux de cirque, ils sont rentrés dans leurs terres. Et Micah True les y a rejoints. Ce serait au monde extérieur de venir les voir, sur leur terrain, de leur apporter du maïs, d'entrer en contact avec leur culture.
Micah True est mort au cours de l'hiver quelques semaines après la septième présentation de cette course pour initiés.
***
Dans un café du centre-ville, François Bourdeau sort de son sac une paire de sandales. Les fameuses huaraches. J'imaginais de légères galettes de cuir. Tu parles. Elles pèsent une tonne. La surface est en cuir. Mais la semelle est faite d'un morceau de pneu de voiture.
Le livre de McDougall a lancé une controverse autour des souliers et de la manière de courir. Sa thèse centrale est que la capacité de courir de longues distances est un facteur décisif de l'évolution de l'espèce humaine. Ainsi pouvait-on chasser des bêtes qu'on finissait par épuiser.
De même, nul besoin de souliers rembourrés pour courir: le pied et tout le corps en fait sont merveilleusement adaptés à cette activité. Trop de coussins autour du pied endorment les muscles et éventuellement blessent le coureur. Le livre est bourré de références scientifiques, mais la sandale des Tarahumaras est une sorte de preuve: voilà le degré zéro de la protection. Et pourtant ils gagnent des ultramarathons avec ça!
«C'est vrai qu'ils courent avec ça, mais ce n'est pas religieux, faut pas exagérer, dit Bourdeau. Offre-leur une paire de Saucony pour voir... Ils vont la prendre!»
Bourdeau était un sédentaire qui avait 40 livres en trop il y a une dizaine d'années. «J'ai décidé de changer, j'ai mis une paire de souliers et je suis parti courir. J'ai couru... 35 secondes! J'en étais presque malade. Mais j'ai trouvé ça libérateur.»
Seul problème, il se blessait sans arrêt. Il arrêtait. Puis recommençait. Et se blessait. Jusqu'à ce qu'il trouve sur l'internet ce qu'on disait de la course nu-pieds. «Ça m'a forcé à changer ma technique et à courir au bon rythme.»
Depuis ce temps-là, il a augmenté ses distances jusqu'à faire son premier marathon en 2010. Pas particulièrement rapide: 4h15. Mais il ne se blesse plus. Et court des ultramarathons (50, 80 km, etc.). Et il a remis ses souliers. «Au Québec, on n'a pas vraiment le choix.»
Il a commencé à tenir un blogue sur la course (Flintland). Et un beau jour, un certain Micah True a demandé d'être son ami Facbook. Il avait lu Born to Run et n'en revenait pas. True ne répondait jamais à ses questions. Mais un beau jour, l'invitation est arrivée: viens donc courir au Copper Canyon avec nous.
Il est parti cinq semaines d'avance. Avion, train, autobus, le voilà dans Bauichivo, village perdu, au mois de février. Caballo Blanco est dans un ranch des environs, par hasard.
«Tu fais quoi demain? Je vais te montrer les environs.»
«Il m'a dit qu'il allait courir 40 km, je n'étais pas prêt, mais va donc dire non à Caballo Blanco. Il court avec une force incroyable, avec une foulée courte, en lançant sa bouteille d'une main à l'autre. Il ne ralentit jamais dans les montées. Il respire fort comme un train à vapeur.»
Il a vécu cinq semaines avec lui, à ne jamais trop parler. Mais à tout partager. Il lui a présenté les gens des villages, qui l'accueillaient en frère. «Ils jouaient du tambour pour son arrivée. Il n'essayait surtout pas d'être un guide touristique. Il n'amenait jamais personne là-bas.»
Arrivé là avec sa montre GPS, ses gels et ses théories, Bourdeau est revenu avec un bracelet en laine, un esprit libéré des performances et aucune envie de mesurer ses temps.
«Il ne me faisait pas de remarques. Il avait une philosophie qui tenait en deux mots: run free. Cours en liberté. Va dehors. Respire. Fais ce que tu aimes sans compter tout le temps.»
***
Un jour, il aperçoit les vieux Saucony de True dans son camion, troués de partout. «J'ai pris une aiguille, des patchs de matelas gonflable et, pendant une demi-journée, je les ai réparés sans lui dire. Il m'a pris dans ses bras. Le fabricant lui en a envoyé des nouveaux depuis...» Le jour de la course, il faisait 38 degrés. Bourdeau a fini parmi les derniers, en 15 heures (le gagnant fait ça en sept heures 20 minutes). «J'ai juste vécu une journée extraordinaire, dans un endroit où la course est au coeur de la culture depuis toujours.»
Trois semaines plus tard, Micah True est disparu pendant une de ses courses dans le canyon. On l'a retrouvé deux jours plus tard. On suppose qu'il a eu un malaise cardiaque dû à une malformation. Il avait eu le temps de s'étendre sur le dos, les pieds dans la rivière, et regardait le ciel.
Et dans les pieds, au lieu de la nouvelle paire, ses vieux souliers «patchés» par François Bourdeau.
PAGE 9
Desjardins :
meilleure entreprise citoyenne du Canada
Isabelle Massé, La Presse(12-06-12)
«En cette année internationale des coopératives, Desjardins entend garder le cap sur la prospérité durable de ses 5,6 millions de membres et de leurs collectivités, que ce soit en renforçant notre expérience membre, en réduisant notre empreinte écologique ou en innovant dans la gouvernance démocratique de notre réseau de caisses», souligne Monique F. Leroux (notre photo) dans un communiqué.
Les deuxième et troisième positions du classement sont aussi occupées par des coopératives, soit la Vancouver City Savings et Co-operators Groups.
Le CN, la Banque Royale, Mountain Equipment Co-op, Hydro One, Enbridge, First Quantum Minerals et Banque HSBC Canada complètent le tableau des 10 premières positions.
PAGE 10
Le capitalisme sauvage existe-t-il?
Claude Chiasson, Le Devoir (09-06-12)
Oui, je vous lis (parfois de biais, lorsque vos chroniques sont trop problématiques et trop techniques pour moi), mais non par besoin, car nous, ma très chère épouse et compagne de vie, Denise, et moi, sommes des gens de conditions matérielles fort modestes. Situation avec laquelle nous composons du mieux que nous pouvons. J’ai une question pour vous.
Est-il exact qu’un capitalisme dit « sauvage » existe ? Si oui, êtes-vous en mesure de nous donner les caractéristiques d’un tel capitalisme ? Et quand un capitalisme dit « sauvage » le devient-il ?
G. B.
Des enfants exploités au travail, des salaires de famine, des journées de travail de 16 heures, des conditions de travail insalubres et dangereuses, tout cela pour que des propriétaires d’entreprise s’en mettent plein les poches, voilà le capitalisme sauvage. Ce type de capitalisme sauvage n’existe plus dans les pays développés.
Chez ces derniers, si capitalisme sauvage il y a, il se trouve essentiellement cantonné dans le secteur de la haute finance. Les marchés financiers sont aujourd’hui complètement dénaturés. Dans ces marchés, les institutions financières créent sans cesse de nouveaux produits dits dérivés de tout acabit, des produits liés à des indices, à des denrées, à la qualité de l’air, à la volatilité des Bourses, à des hypothèques à haut risque, etc.
Des produits conçus pour accroître les volumes de transactions sur lesquelles les institutions financières perçoivent de généreuses commissions pour payer des dizaines de millions de dollars en prime à leurs gestionnaires. Des produits structurés de manière à accroître l’effet de levier à outrance. C’est ainsi que des banques ont pu faire passer leur effet de 10 $ d’actif pour 1 $ de capital à 18 pour 1, à 28 pour 1 (dans le cas des banques américaines avant la crise financière de 2007) et à 40 pour 1 ou plus dans le cas de certaines banques européennes.
Des produits sur lesquels les institutions financières spéculent pour engranger des profits rapides et élevés, mais non sans grands risques. La banque d’affaires américaine JP Morgan nous l’a montré il y a quelques semaines en dévoilant des pertes-surprises de 2,5 milliards $US (qui atteindront probablement 5 milliards) à cause de positions prises sur des produits dérivés.
Certaines banques vont même jusqu’à spéculer tout en mettant en danger l’épargne de leurs clients.
Voilà le genre de capitalisme sauvage que nous vivons depuis maintenant 20 ans. Un capitalisme sauvage certes confiné au marché financier, mais qui a des impacts sur l’économie réelle. D’abord par les iniquités produites en concentrant la richesse dans les mains d’une minorité constituée surtout de financiers, des financiers qui n’ont rien ajouté à l’économie réelle. Car la spéculation ne fait que déplacer l’argent entre les individus. Ce que le spéculateur gagne, il le gagne au détriment d’un autre qui le perd. C’est tout.
Il y a pire. Les produits dérivés créés ne tiennent pas la route. Conséquence : lorsque ces spéculateurs perdent trop, les gouvernements doivent alors intervenir ; et parfois ils se saignent à blanc pour sauver des institutions financières, comme ce fut le cas en Irlande et en Grèce et comme cela est en train de se produire en Espagne. Et cela se fait avec l’argent des contribuables.
Notez que ces contribuables ont aussi profité de cette situation pendant de nombreuses années, en achetant des propriétés qu’ils n’auraient pas pu considérer sans la largesse des institutions financières, en achetant des voitures de luxe à petites mensualités, etc. La récréation s’est terminée pour plusieurs d’entre eux avec la crise financière débutée en août 2007.
Voilà le capitalisme sauvage qui sévit actuellement. Ce capitalisme aboutit à des déséquilibres qui risquent de faire basculer l’économie mondiale dans une profonde récession. En Grèce et en Espagne, ce n’est pas une récession mais une véritable dépression qui sévit actuellement.
À ce capitalisme sauvage de la finance se greffe le courant de la mondialisation porteur du grand choc des mains-d’oeuvre, celle bien payée de l’Occident contre celle au rabais des pays émergents. Ce choc se traduit par la disparition chez nous de centaines de milliers d’emplois manufacturiers, creusant du coup l’écart de richesse entre la classe moyenne et celle des riches.
Pour le moment, les gouvernements ont pu éviter le pire en imprimant directement de l’argent à coup de 1000 milliards de dollars aux États-Unis et en Europe. Espérons qu’ils pourront continuer ainsi le temps de donner le coup de barre nécessaire afin de juguler ce capitalisme sauvage encore très présent dans le secteur financier et de corriger les déséquilibres provoqués par la mondialisation et le choc des mains-d’oeuvre.
PAGE 11
Vousvoulez que BW continue?
Envoyez un courriel à M. Bernard Roy
Dites simplement
''BON Weekend''
Paul et Marc